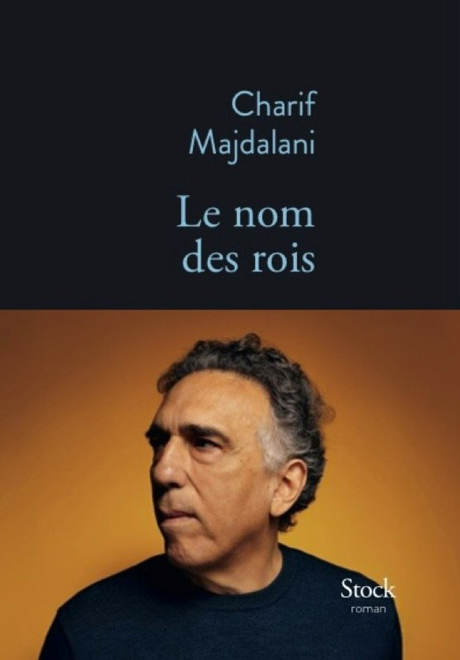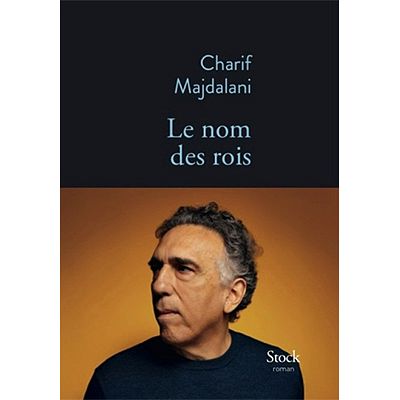« Rodéric, roi des Suèves, un nom barbare et rutilant que rien ne rattachait à ce que je ne connaissais, pur frémissement onomastique » : voici l’entrée en scène lapidaire du premier des rois auquel le nouveau roman de Charif Majdalani doit son titre. Il est suivi par « Axarayactl, roi de Cholula, brutal et angulaire, ainsi qu’une divinité de pierre du Mexique » ; et comment oublier « Receswinthe, roi des Wisigoths, semblable à l’efféminement farouche des bijoux barbares » ?
Présélectionné pour le Prix Goncourt, Le nom des rois raconte l’enfance et l’adolescence d’un garçon fasciné par les royaumes anciens et les épopées mythiques, de Napoléon à Alexandre, qui, à l’aube de la guerre civile libanaise, voit sa conception fantasmée de l’histoire se heurter peu à peu à une réalité « moche, roturière et vulgaire » : celle de la milice et du sang. La quatrième de couverture ne suffira peut-être pas, à elle seule, à nous séduire, reprenant les formules désormais attendues de ces Bildungsromans à la libanaise: la disparition d’un pays, vécue dans l’élan insoumis de l’adolescence; l’enfance insouciante, confrontée aux fracas de l’histoire. Mais chez Majdalani, l’imaginaire n’est pas un élément parmi d’autres de la jeunesse assiégée : il devient le matériau même du récit, cette « précieuse matière sonore » qu’il extrait de sa gangue pour en faire, à la lumière du jour, « chatoyer les formes ».
En effet, dans cet univers sensoriel où l’histoire se laisse doucement fondre dans l’imaginaire, les mots ne se contentent pas de décrire le monde: ils l’engendrent. C’est ainsi que notre narrateur se répétait à lui-même lors d'un voyage en Irak, « comme si le mot [lui] permettrait de mieux jouir de la profonde beauté du spectacle », qu’il assistait là « à un banquet, un banquet, un banquet » — une parole qui fait naître le réel à force de le nommer. Ou qu'à l’inverse, l’apparition de son ancien camarade de classe Kfouri — ou plutôt l’irruption de ce nom, « Kfouri », ravivant avec lui l’univers lointain de la salle de classe d’avant-guerre — dans la montagne où lui et sa famille se sont réfugiés, suffit à annoncer que le monde est désormais sens dessus dessous et que celui lisible et intègre de l'enfance ne reviendra plus.
Du délice au dégoût, du plaisir à la gêne, ce rapport quasi-corporel aux sonorités recèle un certain enivrement, dont on ne saisit vraiment le secret qu’au moment où Majdalani, à travers les poèmes de Clara, nous le livre : « c’étaient la beauté physique et les sonorités des mots qui comptaient, ainsi que leur alliance, comme les couleurs chez les peintres. » Les pages qui précèdent, les montagnes traversées jusqu’ici par des divinités sylvestres et des épopées oubliées, apparaissent alors soudainement comme un vaste tableau, et leurs motifs comme autant de couleurs qu’un peintre patient et passionné aurait choisies et composées afin que nous puissions, à notre tour, en entrevoir le dessein.
Car si Majdalani aime les mots, il les aime en amant jaloux : certains, toujours, reviennent, comme par résonance, laissant apparaître derrière eux de discrets traits de pinceaux: ainsi les princes, les rois, les noms sont-ils « rutilants »; et le « brouillard humide » aux mèches dansantes de Massiaf, montant puis se dégageant de la vallée, ne tarde-t-il jamais bien longtemps à revenir. Majdalani décrit le Liban d’avant-guerre comme une « danse au bord du volcan » ; et son texte en prolonge la chorégraphie, multipliant les visions épiques et les éclats sonores. Cette écriture danse elle-même autour du gouffre qui la menace; elle s’accroche avec ferveur au faste de l’imaginaire; c’est une écriture qui tente de demeurer, aussi longtemps que possible, dans la montagne peuplée de princes fabuleux plutôt qu’aux lisières d'un volcan déjà impénétrable.
Bien sûr, ce jeu ne peut durer éternellement. Si ce roman initiatique contient une leçon centrale, c’est que la pure musicalité des mots et des images finit tôt ou tard par être rattrapée par le réel. D’abord de façon bénigne : le père d’un ami, proclamé « roi des îles du Verseau », déçoit en parlant de banalités. Puis de façon brutale : un troupeau de captifs exhibés par des miliciens, contraints à des postures humiliantes, efface à jamais le souvenir héroïque des Tyriens vaincus dans un vieux livre sur Alexandre. À mesure que la guerre s’installe, il devient inévitable que l’imaginaire, où le narrateur avait jusque-là vécu en admirateur fasciné, entre en collision avec le réel, dont il n’a jamais voulu être qu'un témoin distrait.
Ce heurt prend sa forme la plus théâtrale dans une scène presque trop parfaite pour être crédible, comme les fanfaronnades héroïques que notre narrateur racontait autrefois à ses amis de classe : l’ex de Clara, milicien, le défie lors d'une balade dans la montagne de se servir d’un revolver ; il tire, atteint la cible, et puis, plus tard, couche avec Clara pour la première fois. Tout y est : un défi, une arme, une victoire, une femme. On pourrait croire à une apothéose. Mais derrière l’exploit du narrateur, l’auteur laisse percer un malaise face au « vacarme » qu'il a déchaîné : « je ne savais plus si j’étais heureux de l’avoir ainsi provoqué et d’avoir projeté mon être partout par ce coup de tonnerre, ou honteux d’avoir imposé cela à mes montagnes. » Ce vacarme est autant celui du tir que des mots, qui soudent l’étreinte de Clara et la détonation de l’arme en un même jet de puissance masculine. C'est comme si l’auteur lui-même, en poussant le fantasme à sa limite—en mettant son personnage enfin, et pour de vrai, dans la peau de ces virils conquérants antiques—avait fait dépasser le trait, investissant la montagne non plus de sa musique propre, mais d'un bruit qui lui était jusque lors étranger.
C’est là qu’un relief soudain se dégage de ce roman, en faisant non pas une simple peinture à plat, mais une sculpture en trois dimensions, qui s’élève dans l’espace et force le regard. Si le nom des rois et les poèmes épiques ont été présentés comme une passion profondément privée, marquée par l’écart, le rejet, le surplomb de la réalité, c’est pourtant bien leur friction invisible avec cette réalité qui confère au récit sa force. Au fil des pages, il sera peu à peu devenu impossible, pour un lecteur contemporain, d’échapper au sous-texte imposé par le temps : tandis que l’enfant projetait sur sa montagne des royaumes imaginaires, armé seulement de son crayon, d’autres — adultes et armés pour de vrai — projetaient aussi leurs propres récits sur cette terre trouée de failles qu’était le Liban. Une terre conçue tour à tour comme vierge et disponible : un canevas à remplir, non seulement par le garçon qui, se fondant dans les lignes de son Larousse, y plaçait tribus barbares et rois antiques, mais également par les hommes qui, eux, la recouvraient déjà de leurs trop mortelles imaginations.
Peut-être est-ce donc la violence autant que la complaisance inattendue de ce coup de feu final qui expliquent le singulier écho laissé par le roman longtemps après que l’on a refermé ses pages. Ou peut-être faut-il, là encore, rendre son dû au pur frémissement onomastique. Après tout, Majdalani, c’est aussi un nom qui éveille l’imagination : un nom que l’on se verrait bien écrire pour en éprouver le rythme, s’attardant sur la troisième syllabe avant de glisser vers la quatrième, si toutefois — retenue, soi aussi, par la promesse d'une danse au bord d’un volcan — on avait peiné à s'arracher trop vite à ses montagnes embrumées.
Pour les dates et lieux des rencontres avec Charif Majdalani en France, cliquez ici