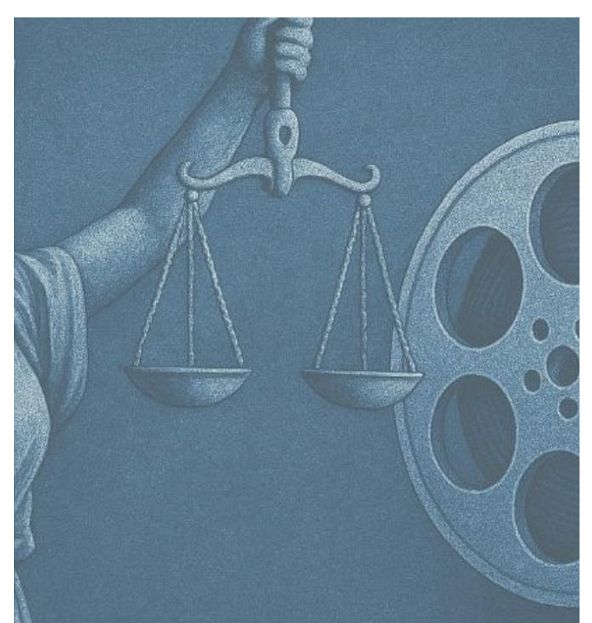Né de la rencontre entre le droit et l’art, le festival Justice & Cinéma, présenté et organisé par le Ministère de la Justice, invite à explorer la justice autrement, à la rendre plus lisible et plus proche du grand public grâce à la force évocatrice du cinéma. Cette édition se déroulera du 29 septembre au 20 octobre 2025, entre le Metropolis Cinema et le Cinéma Montaigne de l’Institut Français du Liban, avec une projection chaque lundi soir à 19 h, suivie d'un débat.
La programmation mêle grands classiques du cinéma français et œuvres libanaises engagées : Les Risques du métier d’André Cayatte (1967), Un crime de Jacques Deray (1993), 12 Angry Lebanese de Zeina Daccache (2009) ou encore Le Président d’Henri Verneuil (1961). Chaque séance se prolonge par un débat public, réunissant juristes, magistrats, cinéastes et producteurs, pour éclairer les dilemmes de la justice à travers le prisme des récits filmés. En rassemblant professionnels du droit, artistes, cinéphiles, étudiants en sciences sociales et en cinéma, ainsi que le grand public, Justice & Cinéma devient un espace de médiation inédit, où se rencontrent réflexion juridique et puissance critique de l’image. 3 questions à Reina Sfeir, Chargée du Festival Justice et Cinéma.
Comment ce festival peut-il rapprocher la justice du grand public et renforcer la confiance des citoyens ?
Le festival Justice et Cinéma offre une passerelle unique entre le monde judiciaire et celui de la culture. En présentant des films qui interrogent la justice sous différents angles, il permet aux participants d’être sensibilisés au monde du droit à travers des récits qui impliquent des personnes dans leur vie ordinaire ou des hommes capables de changer le cours de la vie. Le cinéma rend le droit plus vivant, plus concret, moins abstrait : il met en lumière les dilemmes humains, les conflits éthiques et les espoirs de justice qui nous concernent tous.
Au-delà de la projection, chaque séance est suivie d’un débat animé par des gens du droit et du cinéma. Cette rencontre directe entre experts et public nourrit la réflexion collective et ouvre un espace de dialogue sincère et transparent.
C’est de cet échange que naît la confiance. Le but est de montrer que la justice n’est pas un domaine réservé aux initiés, mais une réalité qui se partage, s’explique et s’écoute. Ainsi, le festival contribue à rapprocher la justice du grand public et à renforcer ce lien essentiel de confiance entre citoyens et institutions.
En quoi le regard du cinéma français sur la justice éclaire-t-il les défis actuels de la justice libanaise?
Le cinéma français occupe une place particulière dans la manière d’aborder la justice : il sait conjuguer rigueur juridique et considération humaine. À travers des récits puissants, il met en scène les tensions entre droit, pouvoir et société, et révèle la complexité des décisions de justice face aux attentes citoyennes.
Ces films offrent au public libanais un miroir critique et inspirant. Ils permettent de réfléchir aux défis actuels de notre propre système judiciaire : l’indépendance des juges, l’accès égalitaire à la justice, la lutte contre l’impunité, ou encore la nécessité de restaurer la confiance du citoyen.
En croisant ces expériences cinématographiques avec notre réalité, nous ouvrons un espace de dialogue comparatif : voir comment ailleurs la justice se confronte à ses contradictions, c’est mieux comprendre nos propres urgences et trouver des pistes d’inspiration pour renforcer l’État de droit au Liban.
Comment prolonger ce dialogue entre justice et culture, notamment auprès des jeunes générations ?
Pour prolonger ce dialogue entre justice et culture, il est essentiel de multiplier les passerelles vers les jeunes générations. Le cinéma, parce qu’il parle leur langage et mobilise leurs émotions, constitue un outil privilégié pour aborder des thèmes parfois perçus comme abstraits ou éloignés de leur quotidien.
Au-delà des projections, il faut créer des espaces interactifs : ateliers de discussion dans les universités et les lycées, rencontres entre magistrats, avocats, cinéastes et étudiants, ou encore concours de courts-métrages sur la justice vus par les jeunes.
En donnant la parole à cette nouvelle génération et en l’invitant à réfléchir par l’art et le débat, on nourrit une conscience citoyenne active, ouverte et critique. C’est ainsi que la culture devient une alliée durable pour rapprocher les jeunes de la justice et leur donner confiance en leur rôle de futurs acteurs du changement.
Pour le programme, cliquez ici