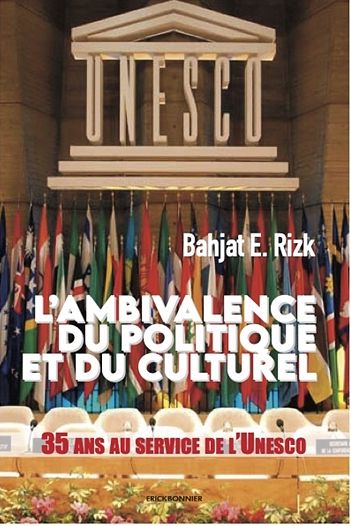
Alors qu’il vient de publier un ouvrage essentiel intitulé L’ambivalence du politique et du culturel, aux éditions ErickBonnier à Paris, Bahjat Rizk, intellectuel et attaché culturel à la Délégation permanente du Liban auprès de l’UNESCO de 1990 à 2025, répond aux questions de l’Agenda Culturel.
Vous dédiez votre ouvrage « aux victimes des conflits culturels à travers l’Histoire ». Comment définiriez-vous un conflit culturel ?
Comme son nom l’indique, le conflit culturel touche un aspect politique de la culture, qui peut être structurant ou déstructurant, et qui risque d’être idéologisé par une volonté politique. C’est pour cela qu’il faudrait disposer d’une définition de la culture, et celle qui convient le mieux, c’est celle qui nous a été transmise par Hérodote, surnommé le père de l’Histoire, il y a 25 siècles, lors des guerres médiques entre les Grecs et les Perses, premier choc culturel entre l’Orient et l’Occident.
Hérodote rapporte cette constatation : « le monde grec est uni par la langue, le sang, les sacrifices et les sanctuaires qui sont les nôtres, et nos mœurs qui sont les mêmes ». Cette définition de la nation, abstraction faite du contenu, est toujours d’actualité aujourd’hui, et le conflit culturel va être l’idéologisation d’un de ces paramètres, qui entraine un clivage ou une division, entraînant une guerre civile à l’intérieur d’une nation ou une guerre entre nations. (Conflits culturels religieux, ethno-linguistiques, raciaux ou de mœurs). L’identité n’est pas statique, mais dynamique, et elle se module autour des paramètres identitaires constatés par Hérodote, qui existent depuis 5000 ans, lors du passage de la préhistoire à l’histoire, avec les premières religions, les premières langues et les premières structures sociétales et économiques.
Vous dites qu’il n’y a pas de débat culturel à l’Unesco. A quoi cela est dû ?
Cela dépend de ce qu’on entend par débat culturel. Il y a des événements et des manifestations culturelles de haut niveau, mais le côté institutionnel et intergouvernemental a marginalisé les intellectuels, qui participent de moins en moins à la vie de l’Unesco, surtout après la réforme des années 2000 de la désignation des membres du conseil exécutif pour assurer le retour des Etats-Unis. La représentation aujourd’hui est uniquement gouvernementale, alors qu’avant on élisait les membres également en fonction de leur parcours (intuitu personae).
Il n'y a pas de droit de veto au conseil exécutif de l’Unesco, car les 58 pays sont sur un même pied d’égalité, ce qui permettait à de grands intellectuels de se faire entendre, et ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, car c’est devenu une représentation purement étatique. Un véritable intellectuel ne peut pas uniquement agir selon des directives gouvernementales, il a besoin de construire individuellement son discours.
L’Unesco est devenue plus une organisation d’experts que de penseurs. De plus, l’Unesco s’est construite après la seconde guerre mondiale selon une philosophie humaniste et universaliste trop optimiste, dépassée aujourd’hui avec la mondialisation, qui reconnait les conflits identitaires dans les faits, mais les nie en même temps de par sa philosophie d’origine, et ne propose aucun cadre pour les prévenir ou proposer des solutions. Comment pouvez-vous débattre de quelque chose qui est à la fois constaté et nié, et que vous n’avez pas défini ?
J’ai eu la chance, pour ma part, d’obtenir une autorisation spéciale du ministre des affaires étrangères de l’époque, monsieur Jean Obeid, qui était un politique, mais également un homme cultivé et éclairé, de poursuivre mes recherches au sein de la délégation, dans les limites du discours proprement politique. Tous les ambassadeurs avec lesquels j’ai travaillé ont accepté obligeamment que je conserve cette marge de manœuvre et de réflexion, en mon nom propre, parallèlement à mon travail statutaire au sein de la délégation, auquel je me suis plié en toute discipline.
Vous établissez un parallèle entre Hérodote, le père de l’Histoire, ayant vécu il y a 2500 ans, et la charte de l’Unesco de 1945 ?
Effectivement, les deux textes, à 25 siècles d’intervalle, empruntent exactement les mêmes paramètres, mais dans un sens diamétralement opposé. Le texte d’Hérodote énonce : « le monde grec est uni par la langue, le sang, les sacrifices et les sanctuaires qui nous sont communs et nos mœurs qui sont les mêmes », et la charte de l’Unesco déclare dans son article premier : « afin d’assurer les droits de l’homme et des libertés fondamentales sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Donc, il faut prendre en considération les paramètres pour constituer les identités collectives qui nous construisent, mais également les dépasser pour atteindre une identité humaine individuelle universelle.
Nous avons besoin de ces deux dimensions de l’identité sans que l’une élimine l’autre. Nous existons en tant que collectivités historiques et géographiques, dans le temps et l’espace, mais également nous tendons vers un idéal humain universel, hors du temps et de l’espace. Idéologiser les paramètres est une erreur qui pousse vers le totalitarisme, mais méconnaitre le vécu des peuples et les spécificités des cultures est également une fuite en avant et un déni des spécificités culturelles. Un être humain n’existe pas dans l’absolu, de manière désincarnée et abstraite. D’autant plus que l’application de la théorie des droits de l’homme est elle-même parfois un alibi pour les rapports de force entre nations. Je soulève juste modestement une problématique qui passe par les mêmes paramètres, pour poser un cadre de négociation, mais je ne prétends pas fournir des solutions, car c’est aux décideurs politiques et économiques de les trouver. J’essaie de suggérer un cadre de rationalité tiré de la coïncidence entre ces deux textes. Les paramètres seront toujours là, qu’ils soient affirmés de manière collective ou rejetés à un niveau individuel. De toute manière, il ne faut pas sombrer dans le dogmatisme et la surenchère, l’identité touche autant l’affectif que la rationalité. Il faut composer, en tant que mortels, entre notre relativité et notre quête d’absolu.
Que faut-il, à votre avis, pour construire une nation ?
La traduction anglaise, dans la définition constatée par Hérodote du « monde Grec », est « the Greek nation ». C’est la première définition de la nation à travers les paramètres, qui a été reprise au XIX siècle par Fichte (en 1807), « Discours à la nation allemande », et Renan (1882), « Qu’est-ce qu’une nation ? », dans des contextes politiques précis. Les textes passent par les paramètres identitaires, soit pour les affirmer, soit pour les nier. Mais vient également s’y ajouter le désir et la volonté de vivre ensemble.
Il n’y a pas d’identité statique, mais un processus d’identification qui soit se construit, soit se déconstruit par interaction, comme toute relation humaine. Il y a donc une projection idéalisée, mais également des réalités démographiques, politiques, économiques, qu’on doit gérer au quotidien, pour la cohésion et la survie du groupe. C’est ce que Claude Lévi-Strauss avait courageusement exploré dans ses deux conférences à l’Unesco, Race et histoire (1952) et Race et culture (1971). Ce sont deux textes majeurs, complémentaires : le premier, humaniste, salué et célébré par l’Unesco ; et le second, réaliste, complétement ignoré, censuré et occulté.
Bien sûr, il n’y a pas de groupe qui aligne les quatre paramètres en même temps, car ce serait une entité mortifère, condamnée à périr asphyxiée, mais il s’agit d’avoir une plateforme culturelle commune (des paramètres communs) qui permette l’identification, et des éléments divergents qui sont perçus comme une valeur ajoutée et non comme une menace. L’identité est une intériorisation, et non une contrainte ou une instrumentalisation opportuniste. C’est pour cela qu’on évoque la patrie.
Vous considérez que le Liban n’a pas défini son identité et qu’il ne peut pas en débattre ?
Le Liban veut à la fois préserver ses communautés religieuses et fonder une nation. C’est un système hybride, toujours provisoire depuis un siècle, qui veut concilier une fédération de communautés dans un système parlementaire unitaire. Il y a des paramètres culturels communs aux Libanais (transcommunautaires), tels que la race, la langue et les mœurs, mais le paramètre culturel religieux divergent définit la vie politique. C’est ce rapport du culturel au politique qu’il faut clarifier dans les sociétés pluriculturelles… Ce qui est le cas de presque toutes les sociétés dans la mondialisation aujourd’hui. C’est pour cela que mon essai s’intitule L’ambivalence du politique et du culturel, et je l’ai vécu tant dans mon expérience de la guerre civile de 15 ans au Liban, que dans mon observation de l’évolution de l’Unesco et les conflits culturels qui se sont multipliés durant ces 35 dernières années.
Que vous reste-t-il de 35 ans passés à l’Unesco et quels en furent les moments les plus importants ?
Il me reste déjà d’avoir vécu selon mes convictions et d’avoir essayé de servir mon pays autant que j’ai pu, dans un domaine qui m’a passionné. Je n’avais jamais envisagé de faire une carrière, mais de remplir une mission qui avait un sens pour moi. Je n’ai jamais rêvé de promotion sociale ou politique, mais d’évoluer humainement et intellectuellement, et de transmettre. J’ai une petite œuvre littéraire et politique, qui ne durera probablement pas, mais qui a compté pour moi. J’ai fait de mon mieux pour traverser ce tumulte en gardant les yeux ouverts, fasciné et épouvanté, avant de rentrer dans le théâtre des ombres.
Séance de dédicace le dimanche 23 novembre, de 16h à 19h
Déli d’Or - 48, Avenue Emile Zola, 75015 Paris
